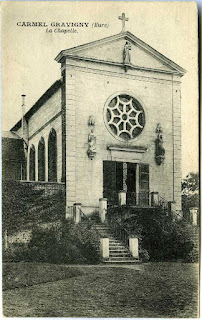mercredi 29 mai 2024
Michée Chauderon – Première partie : Une vie de misère
Vers 1620, elle alla travailler à
Genève, ville protestante, comme domestique.
Ce fut dans cette ville qu’elle
assista à l’exécution de Jeanne Brolliet, brûlée vive, accusée de sorcellerie.
Cet événement marqua, au plus
haut point, la jeune Michée qui n’avait pas encore vingt ans.
Et des horreurs, elle en vécut bien
d’autres.
Une rescapée, Michée, car elle
survécut à plusieurs disettes, celles de l’hiver 1622-1623 et celles des années
1629 à 1631.
Et comme un malheur n’arrive
jamais seul, la population subit de grandes épidémies de pestes de 1628 à 1631
et de 1636 à 1640.
Dans les rues, hommes, femmes et
enfants, déjà affaiblis par la faim, atteints par la maladie tombaient comme
des mouches. Les cadavres restaient là, un temps, avant être ramassés, car les
passants passaient fuyant même du regard les trépassés par peur de finir comme
eux. La mort n’était-elle pas contagieuse.
Ceux qui en réchappaient étaient
marqués à vie et beaucoup sombraient dans l’alcoolisme.
L’alcool, ça réchauffe, ça donne
l’illusion que la vie est belle..... Un temps seulement. Le retour à la réalité
reste toujours brutal.
Michée fut épargnée par tous ces
maux. Célibataire, elle passait beaucoup de temps dans les tavernes avec son
compagnon d’infortune, un ouvrier agricole, veuf, un certain Louis Ducret....
Voilà pourquoi en 1639, elle fut bannie de Genève pour « paillardise [3]».
À l’époque où elle rencontra
Louis Ducret, Michée était grosse de cinq mois d’un valet de ferme décédé
quelques mois plus tôt.
La grossesse n’alla pas jusqu’au
terme.
Michée et Louis se marièrent et
revinrent vivre à Genève. Est-ce que la chance se profilait enfin à
l’horizon ?
Hélas non, car en 1846, Louis
Ducret décéda.
Michée Chauderon se retrouva
veuve avec sur les épaules un passé bien lourd à porter.
Quand je vous disais que Michée
avait une vie de misère !!
Le confetti, symbole de la fête !
Au XIIIème siècle, ce mot italien nommait des bonbons,
des sucreries.
Confetti est le
pluriel de confetto.
Le mot confetti peut
être rapproché :
·
Du russe, konfieta
(bonbon).
·
De l’allemand, konfekt (confiture – sucrerie – dragée).
·
Du français, confit, du verbe confire (préparer – façonner – réaliser
– élaborer). Ayant tout de même un rapport avec les sucreries : fruits
confits.....
Tous ces termes sont issus du même mot
latin : confectus.
Les confettis.... quelques siècles plus tôt, lors du carnaval, les
Italiens confectionnaient de petites boulettes de plâtres qu’ils lançaient dans
la foule.
Depuis 1894, les confettis prirent la forme de petites rondelles
de papier coloré.
Confetti, bien qu’étant
le pluriel de confetto en italien,
prend un « S » au pluriel en français.
Maintenant que vous savez l’histoire de ce mot, vous lancerez,
assurément, les confettis avec plus d’enthousiasme !
Pour cette petite histoire autour d’un mot,
Je me suis aidée du
« Dictionnaire
historique de la langue française » Le Robert
mercredi 22 mai 2024
Oh ! Gnon !
Prendre un gnon !!!
Mais qu’est-ce que c’est ?
Un gnon est un coup porté par une tierce personne ou provoqué par
soi-même par maladresse telle une rencontre inopinée avec une porte restée (on
se le demande bien pourquoi) ouverte.
Ce coup provoque un hématome et parfois, voire souvent, l’endroit
meurtri enfle, gonfle exagérément.
Le gonflement fut comparé à un oignon.
Il n’en fallut pas plus pour que naisse un nouveau mot, vers 1651,
qui désigna depuis lors, le résultat d’un choc puis, par la suite, vers 1853,
le coup lui-même.
Un gnon, assurément un coup-de-poing bien violent.
Pour cette petite histoire autour d’un mot,
Je me suis aidée du
« Dictionnaire
historique de la langue française » Le Robert
Maria Pauer avait seize ans
Mühldorf am Inn, au milieu du XVIIIème siècle, le forgeron Jakob Altinger avait à son service une jeune fille de seize ans, Maria Pauer[1].
Le 25 janvier 1749,
sur la demande de son maître, Maria se rendit faire une course chez un voisin.
Dès le lendemain, il
se produisit dans cette maison des phénomènes inexpliqués : bruits
étranges, coups dans les murs, objets qui se déplaçaient seuls. Visiblement, il
s’agissait de la manifestation du malin. La peur s’empara des habitants du
logis qui s’enfuirent en hurlant.
Après réflexions,
les soupçons se portèrent sur la jeune Maria. N’était-ce pas après sa venue que
les événements avaient commencé ?
Assurément, la jeune
fille avait commerce avec le diable.
Deux jours plus
tard, le 27 janvier 1749, Maria Pauer fut arrêtée par Johann Paul Kürchner,
maire de la ville, et enfermée dans une geôle exiguë dans laquelle elle vécut
deux mois dans des conditions exécrables. Mal alimentée et sans aucune hygiène,
la pauvre Maria commença à dépérir physiquement et mentalement.
Après cette période
d’incarcération, la jeune fille subit, jour après jour pendant deux mois, un
interrogatoire comptant pas moins de cinq-cent-cinquante-sept questions
formulées de différentes manières afin de troubler, d’emmêler l’esprit de
l’accusée. Un interrogatoire habilement mené sous la présidence de Joseph
Heinrich von Zillerberg, infirmier au « Tribunal des soins infirmiers et
municipal ».
Dans la nuit du 31
mars 1749, Maria fut amenée à Salzbourg où elle passa devant des juges. Un
procès qui s’acheva le 11 avril. Ce jour-là, en effet, l’accusée avoua être
coupable.
Pourtant, les juges
n’eurent pas recours à la torture, mais les mots, les phrases, prononcés sans
cesse avaient fini par persuader Maria, qu’en effet, ce que les juges lui reprochaient
était exact.
Deux autres personnes Anna Maria Zötlin et Liesel Gusterer furent arrêtées en même temps que Maria Pauer, pour les mêmes raisons et exécutées en 1749.
Accusée de
sorcellerie, elle fut alors condamnée à la peine de mort par l’épée, puis à
être brûlée[2].
L’archevêque Andreas
Jakob Grad Dietrichstein refusant de la gracier, cette sentence fut exécutée le
6 octobre 1950.
En juin 2009, l'archevêque de Salzbourg, Dr. Alois Kothgasser publia une déclaration sur le procès de
Maria Pauer. Il qualifia la condamnation de « meurtre judiciaire » et de «
crime horrible ».
Maria Pauer fut la dernière personne reconnue coupable de sorcellerie à être exécutée sur le sol de l'actuelle Autriche.
mercredi 15 mai 2024
Caner et canner
Caner :
verbe argotique apparu vers 1821, ayant pour sens « céder – lâcher pied).
Canner :
verbe argotique également, apparu à la même époque que son homonyme caner.
Tous deux auraient un rapport avec canne, en parlant des jambes.
En effet, au début du XIXème siècle, l’expression
« jouer des cannes » atteste la notion de courir, grâce aux jambes.
Une autre expression, « casser sa canne », possède le
même sens.
Les deux mots, proches à une lettre de différence, n’ont-ils pas
été confondus ?
Caner :
renoncer – céder.
Canner : se
sauver et aussi par extension... mourir.
Ne peut-on pas, également, faire le rapprochement avec cette autre
phrase utilisée depuis 1908 :
« Je m’casse !! »,
pour : je me tire – je me sauve, je m’en vais !!
Bon. S’en aller, certes !..... Mais attention où vous mettez
les pieds, car « se casser » précipitamment peut provoquer une chute
et cette chute peut engendrer une fracture osseuse et là.... vous aurez besoin
d’une canne !
Pour cette petite histoire autour d’un mot,
Je me suis aidée du
« Dictionnaire
historique de la langue française » Le Robert
On les disait sorcières...
On les disait sorcières.
Combien de femmes ont été, pour
cette seule raison, brûlées vives sur un bûcher après
avoir été torturées pour obtenir des aveux ?
Elles finissaient par avouer
avoir fait commerce avec le diable afin que le bourreau cesse de les supplicier,
tout en sachant que leurs paroles les mèneraient de toute façon inévitablement à
la mort.
Je vous propose, à partir de la
semaine prochaine, de découvrir des procès en sorcellerie.
Vous ferez connaissance de certaines
de ces femmes bien innocentes de ce qu’on leur reprochait.
mercredi 8 mai 2024
Il y a cancan et cancan
Le mot cancan existe
dans notre vocabulaire depuis le début du XVIIème siècle.
En 1554, il s’écrivait : quanquan
De quam = que (en
syllabe redoublée), il était employé pour : quoique – de toute façon –
pourtant, dans les débats d’école.
Puis un quanquan prit le
sens de : une harangue universitaire.
Vers 1584, ce mot n’avait plus que la valeur de grand bruit autour
d’une chose insignifiante et il
s’orthographia : quanquam.
À son entrée dans le langage courant, ce quanquam fut rattaché au
verbe cancaner prenant très vite le sens de : médisance (1621).
Ce verbe cancaner aurait
été créé en pensant au cri du canard ou de certaines volailles.
Et voilà la raison du changement de quanquam en cancan.
Ce fut sous cette forme orthographique qu’il se répandit et prit
le sens de médire (1829) que nous lui connaissons toujours.
De cancan découle :
·
Un cancanage (1834) : une médisance.
·
Un (une) cancanier
(cancanière) (1836) : celui ou celle qui répand des médisances, des
calomnies.
·
Une cancanerie : sans doute une assemblée
de cancaniers et cancanières cancanant. Concours à celui ou celle qui dirait le
plus de mal des autres. Il faut bien passer le temps !!
Et puis il y a le cancan (1829).
Il s’agit de cette danse tapageuse et excentrique très à la mode
dans les bals populaires entre 1830-1840.
À la Belle Epoque, les cabarets de Montmartre proposaient des
spectacles de cancan. Ceux-ci étaient très appréciés.
Ce cancan devint le « french cancan ». Un coup de pub
pour inciter la venue d’un nombreux public.
Le Moulin Rouge qui vient de perdre ses ailes (fin avril 2024) fut
et est encore le temple du cancan.
À ses débuts, tout Paris, ouvriers et bourgeois, fréquentait
l’endroit. C’était l’euphorie.
Henri de Toulouse-Lautrec y avait sa table. Et on doit à cet
extraordinaire artiste-peintre des affiches et toiles immortalisant les lieux.
Et puis, le cancan ne serait rien sans La Goulue (Louise Weber),
Valentin le désossé (Edme-Étienne-Jules
Renaudin), Nini-pattes-en-l’air (Marie Blanchard), Grille d’égout
(Lucienne Beuze), Jane Avril ......
Le verbe cancaner signifie aussi danser le cancan. Mais je suppose
qu’il faut beaucoup de souffle pour cancaner en cancanant, sans perdre le
rythme !
Aujourd’hui, plus aucun cancan sur ce cancan qui est devenu une
danse, un emblème de la Belle Epoque.
Pour cette petite histoire autour d’un mot,
Je me suis aidée du
« Dictionnaire
historique de la langue française » Le Robert
Au couvent après les événements
Au
couvent, elle se dépensait au soin des vaches, s’occupait de la lessive,
préparait les repas et cuisait le pain. Toujours active, elle ne prenait jamais
de repos.
Elle
soignait également les sœurs les plus âgées.
L’agression
qu’elle avait subie l’avait particulièrement marquée et depuis ce jour-là, elle
fut moins vaillante. D’autant plus qu’en prenant de l’âge, les rhumatismes qui
la faisaient souffrir depuis des années, l’empêchaient de vaquer à ses occupations,
malgré son courage et sa détermination.
Le
mardi 6 septembre 1892, souffrante, elle se leva avec difficultés. Elle devait
faire cuire le pain pour la communauté. Ensuite, elle enchaîna ses tâches
habituelles. Le soir, brisée de fatigue, elle alla se coucher juste après avoir
soupé. Dans la nuit, prise de vomissements, elle dut faire appel aux autres
sœurs.
Dès
ce moment, elle ne quitta plus le lit, son état s’aggravant.
Après
avoir reçu les derniers sacrements, elle décéda le vendredi 16 septembre 1892.
Doyenne
des sœurs du voile blanc, elle était âgée de 63 ans, dont 41 ans et onze mois
de vie monastique.
Sœur
Saint-Barthélemy, née Théodorine augustine Huyard, elle avait vu le jour le 3
octobre 1860 à 11 heures du soir dans une commune de la Somme du nom de Ault.
Au
moment des faits, le 21 novembre 1883, elle n’avait pas encore prononcé ses
vœux. Elle était encore novice.
Peu
de renseignements sur cette jeune femme.
Elle
était la fille d’Anaclet Huyard, marchand potier, et d’ Augustine Ouin.
Elle
décéda au Carmel de Gravigny, le 3 mars 1896 à 1 heure du soir.
Signèrent
l’acte de décès : Albert Cantel, aumônier des Dames du Carmel - 54 ans – et Charles Conard, employé de
préfecture, voisins – 56 ans.
Et
le Carmel d’Evreux ?
Les
recensements de 1891 notent la présence de 26 sœurs dont Théodorine Huyard, 30
ans, et Radegonde Bergeon, 62 ans. En 1896, elles étaient 23.
En
2007, l’évêque d’Evreux ordonna la fermeture du carmel qui fut vendu à un
entrepreneur, Gilles Treuil.
Cinq
mille mètres carrés de toitures enflammés.
Plus
de soixante pompiers venus de diverses casernes du département de l’Eure
vinrent enfin à bout de ce gigantesque incendie à 7 h 30 du matin.
La
chapelle et les ailes du bâtiment furent dévastées, plus de 1 300 m2.
Un
vrai désastre.
À
Gravigny, ce monastère, entouré de végétation, n’était pas classé, mais faisait
partie du patrimoine.
J’ai
fait revivre ce lieu le temps de ce récit, mais je suppose que certains d’entre
vous lorsqu’ils passeront par Gravigny
feront un détour, rue du Carmel, afin de situer le lieu qui a entendu des
chants et des prières et qui a aussi été le théâtre d’une agression.
Les
informations sur les faits proviennent de divers journaux :
- ·
Journal d’Evreux
- ·
Journal la Croix
- ·
Le Petit Républicain de la Haute-Garonne
- ·
L’Avenir de la Mayenne
mercredi 1 mai 2024
Recours en grâce.
Louis
Auguste Semelaigne et Édouard Le Roy retournèrent en cellule jusqu’à ce que la
sentence fût exécutée.
Le
2 mars 1884, le Président de la République, Jules Grévy, commua la peine de
mort en travaux forcés à perpétuité.
Ce
fut le 6 juin 1884 que les deux complices embarquèrent sur le Navarrin en
direction de la Nouvelle-Calédonie.
Voici les fiches de bagne des deux condamnés.
Fils
naturel de Victoire Rosalie Semelaigne.
Né
à Conches-en-Ouche, le 26 octobre 1858.
25
ans.
Sans
domicile fixe.
Ouvrier
maréchal-ferrant.
Condamné
le 21 janvier 1884 par la Cour d’assises de l’Eure (Evreux) pour complicité de
tentatives d’assassinat commises le 21 novembre 1883.
Peine
commuée en travaux forcés à perpétuité (décret présidentiel du 25 janvier 1884).
1
m 70 – cheveux châtains – front large – yeux bleus – nez moyen – bouche moyenne
– menton rond – visage ovale – teint coloré.
Tatoué
d’une pensée et d’une ancre sur le bras gauche. Autres tatouages : un
poignard – un laurier – un trophée de sabres.
De
confession catholique.
Sait
lire et écrire.
Au
bagne, il exerçait le métier de fabricant de sacs en papier.
La
fiche de bagne apprend également que
Louis Auguste Semelaigne avait été condamné :
·
Le 6 juin 1886, à cinq années de double-chaîne
pour évasion.
En
effet, il avait pris la poudre d’escampette le 11 avril 1886. Il fut repris
presque aussitôt, le 14 avril 1886.
Par
décision présidentielle en date du 7 octobre 1890, remise du reste de la peine
de la double-chaîne.
·
Le 8 mars 1901, à cinq années de réclusion
cellulaire pour assassinat et vol.
Par
décret présidentiel en date du 9 octobre 1906, remise de la peine de réclusion
cellulaire.
Sa
fiche porte les mentions de : ivrogne – libertin – débauché.
Louis
Auguste Semelaigne décéda à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), le 27 avril 1918.
Entre
le 10 septembre 1881 et le 25 mai 1883, Louis Auguste Semelaigne avait été
condamné sept fois. Il avait effectué 16 mois et demi de prison et avait payé
47 francs d’amende.
Les
motifs d’incarcération furent toujours les mêmes, des délits mineurs de :
outrage à agent – ivresse – vagabondage – vol, et surtout filouterie
d’aliments.
Fils
de Germain Leroy et Renée Lotin.
Né
à Lambézellec – près de Brest - le 23 mars 1859.
Sans
domicile fixe.
Journalier
– se dit « ajusteur ».
Condamné
le 21 janvier 1884 par la Cour d’assises de l’Eure (Evreux) pour complicité de
tentatives d’assassinat commises le 21 novembre 1883.
Peine
commuée en travaux forcés à perpétuité (décret présidentiel du 25 janvier
1884).
1
m 54 – cheveux blonds – front large – yeux gris bleus – nez moyen – bouche
petite – menton à fossette – visage rond – teint coloré.
Tatoué
d’une étoile sur la main droite et d’un bracelet autour de chaque poignet.
Estropié
de la jambe droite.
Sait
lire et écrire.
Au
bagne, il exerçait le métier d’effilocheur. Il est d’ailleurs noté :
travailleur par excellence.
Édouard
Le Roy effectua une tentative d’évasion le 12 novembre 1890 qui faillit bien
réussir totalement, mais il fut repris le 16 mars 1892.
Par
contre, il récidiva le 21 janvier 1897, et là, il ne fut pas repris.
Tout
comme son compère Louis Auguste Semelaigne, Édouard Le Roy avait, avant
l’agression au Carmel, effectué plusieurs courts séjours en prison et écopé
d’amendes de faibles montants. Des condamnations pour : vol – vagabondage
– ivresse........
Des
délinquants, et non des grands bandits.......